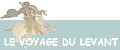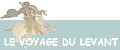|
|
 |
 |
 |
|
L'image
du monde en Grèce archaïque.
(Ballabriga, Les Fictions d'Homère, Paris, PUF, 1999.)
|
|
Dans un livre
récemment paru, "Les Fictions d'Homère, l'invention
mythologique et cosmographique dans l'Odyssée", Alain Ballabriga
s'élève contre l'idée régnante, dans les années
1960 et suivantes, selon laquelle les voyages d'Ulysse seraient un périple
purement imaginaire, sans aucun lien avec les réalités de
la Méditerrannée ancienne. Il s'attache à montrer,
avec des historiens de la colonisation grecque archaïque comme Irad
Malkin, que les évidentes aberrations de la géographie impliquée
dans l'Odyssée s'éclairent si l'on comprend que le levant
et le couchant ne s'opposent pas seulement comme deux directions contraires,
mais convergent comme les confins du monde empiriquement connu. Et pour
figurer cette représentation du monde expérimenté par
les Grecs de l'époque archaïque (VIIÁ-VIÁ siècle av.J.C.),
cet helléniste en donne la carte mentale (carteXX 3). On y voit comment
les voyages partant de Grèce vers le levant ou ceux partant vers
le couchant peuvent suivre des routes préalablement connues, tout
comme ceux qui partent des confins orientaux ou de ceux qui partent des
confins occidentaux en direction de la Grèce. Au contraire, les voyages
situés au nord d'une ligne reliant le couchant d'été
au levant d'été, et ceux situés au sud d'une ligne
symétrique reliant le couchant d'hiver au levant d'hiver sont le
fait exclusif de figures et de pays mythologiques : le soleil, la lune et
les étoiles, Herakles, Jason et les Argonautes, les Hyperboréens
et les Ethiopiens, l'Océan. Plus, donc, on s'éloigne par la
navigation de la zone centrale du monde grec et de ses colonies, moins la
connaissance des routes nautiques est pour les Grecs de l'époque
arcahïque empiriquement certaine ; plus, donc, l'information sur ces
routes garde un caractère légendaire ou mythologique et l'emporte
sur l'information de caractère technique ou pratique. 
|