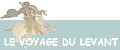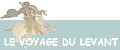|
|
 |
 |
 |
|
Le
marié et la mariée devant la dot, Bansko, Bulgarie,
1989.
|
|
Voici que le
22 octobre 1989, en plein régime communiste jivkovien, un groupe
de jeunes gens sort d'une habitation à Bansko dans le Pirine. Il
se forme dans la rue et se met en cortège. Quatre musiciens les précèdent :
l'un joue de la clarinette, un autre du tambour, le troisième de
l'accordéon, le quatrième s'apprête à chanter
en s'accompagnant d'un instrument à cordes pincées, une serviette
brodée jetée sur l'épaule gauche, à destination
manifestement rituelle. Tous sont vêtus à l'occidentale (...),
tout indique, pour qui possède les codes de la culture locale, que
le cortège en question est un cortège de noces (...). Rien
que de très ordinaire en ces lieux : il y a plusieurs mariages
le dimanche, en cette période de l'année (...). Rien d'archaïque
non plus, apparemment, pour un observateur étranger qui viendrait
à la recherche de survivances supposées ou de traces du paganisme
antique, ou prétendu tel. Et pourtant cette alliance entre lignages
locaux, célébrée par des noces, va mobiliser, par son
cérémonial, des richesses sémantiques et des ressources
cognitives insoupçonnées de ses acteurs mêmes (...).
Il suffit, pour s'en convaincre, de suivre le déroulement de la cérémonie
elle-même. Non, certes, comme une observation qui prétendrait
saisir la réalité effective, en l'objectivant. Mais comme
une série d'évènements auxquels les sujets agissants
ont longuement pensé à l'avance, sur lesquels ils se sont
interrogés dans l'hésitation ou dans la conviction, en vue
de se conformer à la norme ou de s'en écarter, dans l'intention
aussi d'exploiter les ressources que leur offre la coutume ou dans l'intention
d'innover. La performance effective est ainsi à prendre, dès
la description, comme le produit des transactions passées au préalable
entre les acteurs, tant diffèrent les perspectives selon lesquelles
chacun se prépare à tenir son rôle. Car les questions
qu'ils se posent sont, plus ou moins explicitées, les questions mêmes
que se posent les autorités locales en charge des rites : l'église,
le métropolite et les prêtres; la municipalité, le maire
et les officiants de l'état-civil; le maître de chant, de musique
et de danse, avec ses musiciens. Pour tous, pour ces agents et ces officiants
de l'activité rituelle, l'interrogation procède d'une question
unique, fondamentale : Comment allons-nous traiter, pour la performance
particulière en préparation, le scénario issu de la
tradition locale? Et puisque des marges de liberté nous sont offertes
dans la limite des contraintes imposées par la coutume et par le
régime, qu'allons-nous faire de cette liberté? Et pour signifier
quoi?  |