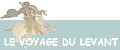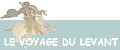|
|
 |
 |
 |
|
Après
avoir achevé sa formation professionnelle, le compagnon Labrie
l'Ile d'Amour quitte Bordeaux avec son escorte rituelle pour regagner
Paris, sa ville natale. Aquarelle, vers 1826.
|
|
Pendant l'Ancien
Régime, les compagnons et les apprentis étaient groupés
en corporations, dans la dépendance des maîtres. Ils vivaient
le plus souvent sous le toit de l'un d'eux "à son pain, pot,
lit et maison". Cet usage demeurait encore en vigueur dans beaucoup
de métiers à la veille de la Révolution. Après
l'abolition des corporations, les ouvriers des métiers ne se sont
pas trouvés isolés. Des isntitutions existaient depuis le
Moyen Age, les compagnonnages, qui avaient pour but la défense matérielle
et morale des ouvriers, ainsi que la distribution de secours. Elles allaient
devenir, en peu d'années, le lieu privilégié de la
transmission des savoirs et un facteur puissant d'innovation par la pratique
généralisée du Tour de France.(...) Le but de l'institution
est, d'après les compagnons eux-mêmes, "la transmission
du métier, non seulement dans ce qu'il a de purement technique, mais
dans ce qu'il présente de formateur" . Toute l'organisation
est donc dominée par le souci pédagogique: "Le Compagnonnage
est non seulement une société de secours mutuel, mais l'académie
de la classe ouvrière", affirme un compagnopn de 1860, Chivin,
de Die, dit François-le-Dauphiné. C'est en fonction de ces
buts qu'il faut en comprendre les deux dispositifs majeurs: l'initiation
qui passe par l'adoption, la réception et la finition, et le Tour
de France.  |